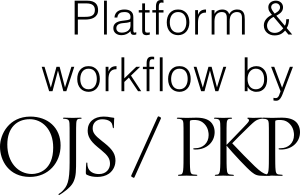Migration journalière et distribution saisonnière verticale du zooplancton dans la région profonde de l'Adriatique
Abstract
Les investigation relatives à la distribution verticale du zooplancton, qui été effectuées, jusqu’à présent, en Adriatique méridionale, se sont bornées eaux assez basses, jusqu’à 150 m de profondeur. On ne possédait aucune donnée sur la migration journalière des organismes planctoniques. Mais, après avoir observé que les espèces plus profondes constituaient une notable partie de la biomasse planctonique, et qu’à ces profondeurs il était impossible de suivre toute l’année la distribution verticale de tous les planctontes, quantivement plus important, on a réexaminé, sur une station plus profonde, les résultats antérieurs des recherches, qui ont été complétés par les données sur la migration journalière.
Les recherches se sont poursuivies, toute l’année, sur deux stations fixes, au sud de Dubrovnik, à des profondeurs respectives de 230 et 330 m. Sur la base des données obtenues à ce jour (H u r e 1955), et de celles figurant dans ce travail, on peut tirer les conclusions suivantes relatives à la distribution u verticale du zooplancton dans les eaux du large de l’Adriatique méridionale.
1. Sur la station plus profonde, presque la moitié des organismes planctoniques a présenté une distribution verticale notablement plus large que sur la station précédemment explorée, de 150 m de profondeur.
Cette constatation est valable surtout pour les ostracodes, un grand nombre de copépodes et certains hétognathes. Les autres groupes planctoniques, dans leur ensemble - sauf quelques espèces - n’ont pas manifesté de changements un peu plus significatifs (tableau II).
2. C’est seulement sur la station plus profonde qu’on a pu établir une corrélation entre la diffusion verticale du zooplancton et le niveau moyen du jour, c’est-à-dire avec la profondeur à laquelle se tenait le noyau de la population de ces organismes au cours de l’année (figure 58). On a, en outre, constaté que les espèces plus profondes présentaient une diffusion verticale plus large que celles qui vivaient plus près de la surface et que, à 300 m, on peut suivre toute l’année, sans interruption, la distribution verticale de l’énorme majorité des zooplanctontes - un petit nombre d' espèces excepté - habitant les eaux plus profondes de l’ Adriatique (Archiconchoecia striata, Pleuromamma abdominalis, Sagitta decipiens, Scolecithricella dentata).
La migration journalière a été étudiée en mars, juin et septembre à des profondeurs supérieures à 200 m. D’après les données recueillies durant ces périodes de temps, on a pu faire les observations suivantes:
1. La grandeur de la migration journalière de chaque espèce varie, en cours d’année, suivant l’intensité de l’éclairement et l’effet de la température. En juin, quand la pénétration de la lumière du jour est la plus forte, presque toutes les espèces se livrent à la migration journalière la plus grande. En fin d’été, au fur et à mesure que décroît l’intensité de l’éclairement et que les couches d’eau de surface se réchauffent, la migration journalière des animaux planctoniques diminue aussi graduellement. En mars, coincidant avec les stratifications homothermes, la migration journalière présente les proportions les plus faibles et, chez un nombre notable d’espèces, elle est même à peine perceptible (Calanus gracilis, Calanus minor, Mecynocera clausi, Corycaeus typicus, Conchoecia spinirostris, Sagitta enflata et beaucoup d’autres encore).
2. On a établi, pour la majorité des espèces, l’existence d’une corrélation entre la profondeur de leur habitat diurne (niveau moyen journalier) et la grandeur de leur migration journalière. Les espèces profondes sont soumises à une migration de plusvastes proportions que celles qui se tiennent près de la surface (figure 62).
3. On a observé que le moment de l’immersion nocturne n’est pas le même pour chaque organisme. Les espèces de surface se trouvent régulièrement en surface au crépuscule et même avant le coucher du soleil alors que les formes profondes n’atteignent, le plus souvent, les eaux de surface que tard dans la nuit (Archiconchoecia striata, Conchoecia clausi, Aetidus armatus, Euaetideus giesbrechti, Pleuromamma gracilis, Scolecithricella dentata, Corycaeus furcifer, Krohnita subtilis).
4. On a constaté que l’accroissement du volume à la surface, pendant la nuit, ne correspondait pas, à toutes les époques, synchroniquement, avec le coucher du soleil.
En septembre, cet accroissement, chez de nombreuses espèces, a été observé plus tôt qu’en juin, et en mars, plus tôt qu’en septembre. Cependant, la diminùtion du volume en surface, à l’aube, coïncidait en juin et septembre avec le lever du soleil (figures 60 et 61). Ce phénomène semble être en relation avec la profondeur à laquelle vivent les organismes planctoniques pendant le jour et avec les fluctuations saisonnières quantitatives des formes de surface.
5. Le phènomêne d’inmmersion nocturne n’a été observé avec certitude que chez deux espèces (Oncaea mediterranea et Sagitta enflata), mais on a pu le pressentir chez certains organismes apparaissant en surface au crépuscule ou avant le coucher du soleil (Lensia subtilis, Sagitta serratodentata, Sagitta minima).
6. Il a été démontré que beaucoup d’espèces sont plus abondantes en surface par pleine lune et que le degré de concentration est le plus élevé chez les formes profondes et chez celles qui se livrent à une large migration journalière (Conchoecia spinirostris, Conchoecia clausi, Calanus gracilis Euaetideus giesbrechti, Scolecithricella dentata, Pleuromamma gracilis, Stylocherion suhmii).
7. Les données figurant sur le tableau III, relatives à la corrélation entre le niveau journalier et l’ennuagement confirment les allégation de nombreux auteurs qui ont remarqué que beaucoup d’espèces se tiennent plus près de la surface par temps couvert que durant les jours ensoleillés.
8. On a établi que, à toutes les époques, la biomasse totale des zooplanctontes, depuis la surface jusqu’au fond, est à peu près égale le jour et la nuit. Mais, on a remarqué que la biomasse, par couches d’eau, vane de façon notable en juin et septembre, alors, que, pendant l’homothermie de mars, elle ne présentait pas d’écarts sensibles. Ce phénomène confirme donc la constatation énoncée: la migration journalière des organismes planctoniques est la plus forte en juin, époque où elle intéresse le plus grand nombre d’espèces. En mars, par contre, elle s’atténue notablement et se borne à un nombre restreint d’espèces plus profondes sans influence essentielle sur les modifications de la biomasse par couches.
9. On a prouver que la force, l’époque et la durée de la migration horizontale des organismes planctoniques des eaux plus profondes de l' Adriatique sud, vers le nord sont conditionnées, avant tout, par le niveau où vit chaque espèce pendant l’annèe et par le caractère de sa migration verticale.
10. Des formes nombreuses connues pour être très rares dans l'Adriatique septentrionale et moyenne ont été, souvent, dans cette région un importance quantitative assez grande.
Un assez grand nombre d’espèces nouvelles pour l’Adriatique ayant été trouvées, ces eaux sont donc encore toujours insuffisamment connues et du point de vue qualitatif.