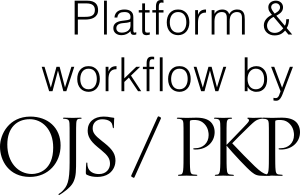Famille des Champiacées (Champiaceae) dans l'Adriatique moyenne
Abstract
Ces notes sont consacrées à l’étude anatomique et morphologique de 15 espèces. Ce sont: Lomentaria linearis, L. subdichotoma, L. clavellosa, L. tenera, L. compressa, L. firma, L. jabukae, L. chylocladiella?, L. clavaeformis, L. species, Champia parvula, Chylocladia kaliformis, Ch. pelagosae, Ch. reflexa et Gastroclonium clavatum.
A propos de l’espèce L. linearis sont soulignés les caractères différentials par comparaison avec l’espèce L. articulata. La première, au point de vue morphologique, n’apparaît que comme une forme profonde de la seconde, et n’en diffère un peu plus nettement ni par sa structure anatomique ni par la disposition, souvent irrégulière, des organes reproducteurs. Elle s’en écarte, principalement, par sa distribution géographique et son habitat profond.
En se basant sur le fait que L. articulata peuple les eaux atlantiques et superficielles et L. linearis les eaux méditerranéennes et plus profondes, l’auteur conclut que la séparation taxonimique et l’indépendence de l’une et l’autre espèce s’appuient davantage sur des caractères géographiques et écologiques que morphologiques et qu’il s’agit ici de ce qu’on nomme des espèces vicaires.
Dans plusieurs localités et toujours à des profondeurs notables, on a trouvé et décrit comme une espèce nouvelle L. subdichotoma, qui, par son aspect extérieur, ressemble beaucoup à L. linearis, mais, outre ses dimensions plus exigues, elle présente aussi une structure anatomiuque plus simple.
Dans le cycle de l’espèce L. clavellosa est décrite comme une forme particulière - reducta - qui diffère du type per la structure plus simple du cortex.
L’auteur a décrit ici comme une espèce nouvelle (L. tenera) une forme récoltée près de Jabuka à une assez grande frofondeur, qui se sépare de l' espèce L. clavellosa par les dimensions moindres de son thalle et sa structure anatomique plus simple.
Sont reportées ici certaines données concernant la structure des espèces L. compressa et L. firma.
On décrit sous le nom de L. jabukae une espèce trouvée sur le rivage de l’îlot de Jabuka, qui, par la forme de son thalle rappelle un peu les deux précédentes, mais au point de vue anatomique, elle se rapproche de l’espèce L. linearis.
On trouve, ici, une description du thalle et des organes reproducteurs d’une espèce ramassée près de l’îlot de Sušac et que l'on amène (provisoirement) en relation avec L. chylocladiella F u n k tout en suggérant la possibilité de son indépendance taxonomique.
Une Lomentaria dépourvue de ramifications et dont l’aspect rappelle celui d’une massue, trouvée aux abords de Jabuka, est décrite comme une espèce nouvelle L. clavaeformis.
Sont publiées des notes sur une forme dont il a été impossible de déterminer la position (L. species).
On y mentionne les caractères morphologiques et anatomiques ainsi que des données sur la répartition des espèces Champia parvula, Chylocladia reflexa et Gastroclonium clavatum.
Dans le cadre de l’espèce variable Chyl. kaliformis, l’auteur décrit trois groupes de formes: à cortex bistratifié, intermédiaire et unistratifié. A propos de ces formes, on indique, aussi, en plus des caractères généraus, ,,les caractères spécifiques de variabilité” se rapportant, pour une part à certaines particularités morphologiques (forme et longueur des articulations, mode de ramification) et, pour une autre part, à des particularités anatomiques (réduction moindre ou plus accusée du cortex) que l'auteur juge être de nature constitutive et non phénotypique, et qui font preuve, entre eux, d’un parallèlisme constant. Les variantes extrêmes de la variabilité apparaissent - selon l’auteur - sous forme d’espèces differentes de rang inférieur appartenant à la même espèce de rang supérieur, ou plutôt, à la même superespèce. L’auteur distingue donc les espèces Ch. kaliformis bistratosa et Ch. kaliformis unistratosa qui divergent sensiblement non seulement par leur habitus, mais aussi par la structure anatomique du thalle et entre lesquelles s’echelonnent des formes intermédiaires.
Quant aux formes décrites par certains chercheurs sous le nom de „squarrosa”, l’auteur pense qu’elles ne sont que des formes écologiques de l’espèce „bistratosa” ou „unistratosa”.
Chez Ch. kaliformis unistratosa on a constaté la présence simultanée de tétrasporanges et de cystocarpes sur un même exemplaire.
Suit la description, sous le nom de Ch. pelagosae, d’une nouvelle forme de Chylocladia trouvée près de Palagruža.
Dans la famille des champiacées, l’auteur distingue deux groupes d'espèces: un groupe à cortex multistratifié et un groupe à cortex unistratifié. En amenant ces deux groupes en relation étroite avec leur répartition profonde il est arrivé à constater que toutes les espèces à cortex multistratifié (sauf une seule, L. linearis) qu’il a récoltées en Adriatique sont des espèces de surface, tandis que celles qui ont un cortex unistratifié (sauf Champia parvula) sont des espèces profondes. En s’appuyant sur cette constatation, l’auteur conclut qu’il existe un rapport de cause à effet assez étroit entre la structure du thalle et la profondeur de l’habitat et que la famille des champiacées, dans son ensemble, prouve par sa structure une adaptation à la profondeur, celle-ci ayant, semble-t-il, agi en tant que facteur de sélection sur la survivance de certaines variantes (mutations), c’est-à-dire sur la genèse et la conservation de certaines espèces.
Le texte est illustré par des dessins de toutes les formes étudiées et les diagnoses sont donnees en latin.