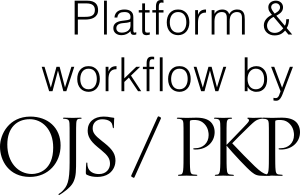Contribution à l'étude de l'oecologie de la sardine (Sardina pilchardus Walb.) dans l'Adriatique orientale
Abstract
Les recherches sur la sardine (Sardina pilchardus W a l b.) de l'Adriatique orientale ont été effectuées afin de contribuer à la connaissance de son oecologie, dans le sens le plus large. Elle se sont poursuivies dans la période de 1946 à 1952 et, pour la plupart, pendant la saison de pêche. C’est pour des raisons d’ordre technique que la région de la Dalmatie moyenne a pu être soumise aux études les plus intensives.
Au cours de ces recherches qui ont porté sur un nombre d'échantillons relativement grand on a pu faire les observations suivantes:
1. - Le nombre de vertèbres de la sardine dans l’Adriatique orientale a varié de 49 à 54. La plus fréquente a été la classe de 52. A côté du mode, la classe la mieux représentée a été celle de 51 alors que celles de 50 et de 53 l'étaient faiblement, et 49 et 54, à titre exceptionnel. Une telle répartition du nombre de vertèbres n’a pas été établie pour la saison de pêche seulement, mais aussi en dehors et en pleine ponte, ce qui prouve que la sardine qui fait l'objet de notre pêche régulière se tient tout le long de l’année dans les eaux de l'Adriatique orientale. Etant donné qu’une telle répartition a été enregistrée aussi pour la jeune sardine, on en a conclu qu’elle caractérise vraiment le poisson de l’Adriatique orientale et que noire pêche se pratique principalement aux dépens de la jeune sardine qui peuple les eaux côtières de cette région. Ces constatations sont susceptibles de présenter un certain intérêt en vue d’une administration rationnelle de la pêche sardinière.
S. M u ž i n i ć (1936) a trouvé aussi une même répartition du nombre de vertèbres dans ses recherches en 1931 sur la sardine de la Dalmatie moyenne. Ce fait, ainsi que la faible amplitude des fluctuations de la répartition de ce caractère, établie entre 1946 et 1952, amène à conclure que cette répartition, chez la sardine adriatique orientate, est relativement constante et que, comme telle, elle est susceptible d’être utilisée pour l'identification de la population examinée.
La répartition du nombre de vertèbres notée pour la sardine de l'Adriatique orientale, présente une ressemblance avec celle de la sardine méditerranéenne septentrionale. Cette similitude entre deux populations géographiquement séparées n’a pu être expliquée.
Dans la région soumise à nos investigations, on a observé aussi, quoique très rarement, l’apparition d'une répartition vertébrale au mode 51. A côté du mode, la classe la plus fréquente était de 52. Une telle répartition, dans l'Adriatique orientale, semblable à celle qu’on observe chez la sardine de la Méditerranée méridionale et chez celle de la Met Egée n’a pu être expliquée. On a supposé, en attendant, qu’elle traduisait la présence d'une population étrangère a la région. L’apparition exceptionnelle du mode 51 permet de conclure à l’homogénéité notable de la population au mode 52 que l'on rencontre dans l’Adriatique orientale, et en particulier dans la Dalmatie moyenne.
2. - Un dimorphisme sexuel, quant au nombre de vertèbres, n'a pu être établi pour la sardine adriatique, ce qui cadre avec les observations faites par d’autres auteurs au sujet de la sardine de la Méditerranée et de l’Atlantique.
3. - Une corrélation entre la taille et le nombre de vertèbres ne semble pas devoir être de règle chez la sardine de l'Adriatique orientale. En ce qui concerne la corrélation positive observée pour le prélèvement de la baie de Vlora, on l'a supposée due à l’hétérogénéité du stock sur lequel cet échantillon a été prélevé.
4. - L'analyse du cycle sexuel, d'après l’état de maturité des gonades, a montré que la ponte de la sardine, dans l'Adriatique moyenne, se situait en hiver et, probablement aussi, au début de printemps et tard en automne. Ceci s’accorde avec la constatation de G a m u l i n (1948) et avec la plupart des observations antérieures au sujet de la période de ponte de la sardine adriatique.
La période juin-août représentait la phase de repos sexuel tandis que les mois de septembre et octobre et, jusqu’à un certain point, de novembre marquaient la période de prématuration dans le cycle sexuel de ce clupéidé.
5. - L’évolution sexuelle, dont les débuts ont été lents, allait ensuite s'accélérant ainsi que le prouve l'analyse des fluctuations du poids des gonades en fonction du temps.
6. - La marche de la maturation sexuelle n’a pas été identique pour tous les individus devant prendre part à la ponte. Chez ceux d’une taille élevée, ce processus se déclenchait plus tôt, ainsi que l’indique l’étude de l’état des gonades et l’analyse de leur poids en fonction du temps.
7. - Les gros spécimens des deux sexes ont accusé des valeurs du poids des gonades et du rapport gonosomatique supérieures à celles con statées chez les exemplaires plus petits. L’existence d'une différence de ce genre, en ce qui concerne le rapport gonosomatique, même pendant la période de repos dans le cycle sexuel, décèle une allométrie de la croissance pondérale des gonades.
8. - L'evolution sexuelle commence, à en juger par les données recueillies sur le poids des gonades, en même temps chez les deux sexes. Cependant, dans la phase de prématuration, elle s’est manifestée plus nettement chez les mâles que chez les femelles, de sorte qu’ils présentaient alors des stades de maturité plus avancés que les femelles. On a aussi observé chez les mâles, dans la phase de prématuration, des organes sexuels plus lourds. Cette différence est probablement déterminée par la dépense plus grande de réserves engagées dans la maturation des femelles.
9. - Une comparaison entre les variations du rapport gonosomatique et celles du poids des gonades nous a permis d’observer une réduction du poids au cours de la période d’activité sexuelle maxima.
10. - La sardine de l'Adriatique moyenne présente les symptômes de l'activité sexuelle avec une taille de 13 à 14 cm. Cependant, une bonne partie du poisson atteint déjà la maturité sexuelle avec une taille de 12 à 13 cm et pour quelques spécimens elle se déclenche même au-dessous de 12 cm.
11. - Le quantum de graisses périintestinales chez la sardine de l’Adriatique moyenne varie en cours d’année. Faible après la ponte, il allait ensuite en augmentant. Cette observation s’accorde, d'une façon générale, avec celle qui a été faite précédemment (K r v a r i ć et R. M u ž i n i ć, 1950). A l’époque de la ponte on a noté que les viscères de la sardine ne portaient aucune trace de graisse. Le cours des fluctuations de la quantité de graisses périintestinales traduit une relation avec le cycle sexuel. Cette opinion est aussi celle de certains autres auteurs qui se sont occupés de l'étude des fluctuations de la quantité de graisses périintestinales chez la sardine méditerranéenne et atlantique.
Chez le poisson de taille réduite on a trouvé des réserves de graisse moins abondantes que chez le gros poisson, ce qui cadre également avec l’observation faite antérieurement (K r v a r i ć et R. M u ž i n ić, 1950). C’est surtout au cours de sa première année que la sardine a peu de graisse autour du tube digestif. Une adiposité faible chez les individus appartenant au groupe O a été notée aussi dans d'autres régions de distribution de la sardine et elle a été mise en relation avec la croissance intense des jeunes sujets.
12. - La proportion des sexes dans les captures provenant de l’Adriatique moyenne a accusé une amplitude notable des variations. Les valeurs les plus aberrantes du rapport mâles/femelles ont été établies pour les prises au chalut de l’automne finissant et de l’hiver, ce qui est la conséquence de l’application de techniques de pêche interdisant une capture numériquement proportionnée de mâles et de femelles à l'époque où les deux sexes se tiennent à des niveaux différents. L e G a l l et P r i o l (1930) ont, en effet, constaté que, pendant la période de ponte, les femelles de la sardine atlantique se tiennent plus près de la surface que les mâles. Une disproportion des sexes, pendant la ponte, a été observée également par A n d r e u et R o d r i g u e z - R o d a (1952), pour la sardine de la côte ibérique orientale.
Des cas fréquents de proportion aberrante des sexes ont été aussi notés dans nos captures et pendant la phase de prématuration. On en a donc conclu que pendant cette période, les mâles et les femelles ne séjournaient pas au même niveau. M u r a t (1935) a, lui aussi, remarqué une disproportion des sexes à l'approche de la ponte. B a r d á n et N a v a r r o (1952) ont constaté également l’apparition d’un déséquilibre des sexes dans les échantillons de sardines provenant de la côte méridionale méditerranéenne de la Péninsule ibérique pendant la ponte ou un peu avant.
13. - L' examen de captures effectuées dans la Dalmatie moyenne a permis de marquer une différence de taille entre mâles et femelles à l'avantage de ces dernières, ce qui s’accorde avec les observations d'autres auteurs sur la sardine méditerranéenne et atlantique, ainsi qu'avec celles de S. M u ž i n i ć (1936) au sujet de la sardine adriatique. Dans certains cas, des différences entre mâles et femelles se sont aussi manifestées dans la taille modale. Les données recueillies indiquent que cet aspect du dimorphisme sexuel exerce, dans les cas de disproportion des sexes, une influence sur la composition des échantillons suivant la taille.
14. - D’après l’analyse de la composition des captures, quant à la longueur totale, on a établi, dans la région des îles de Vis, Biševo et Svetac, la présence de sardines de taille plus élevée que dans la baie de Kaštela. La sardine de la partie nord-ouest de l'île de Hvar, a occupé, en quelque sorte, une situation intermédiaire par rapport aux deux régions prémentionnées. G a s t (1925) avait déjà remarqué que la sardine capturée dans les canaux était plus petite que celle de la haute mer. Mais, à son avis, celle des canaux appartenait à une autre race. S. M u ž i n i ć (1936), d’après ses études sur la sardine de la Dalmatie moyenne, pendant la saison de pêche 1931, a conclu que la taille du poisson variait suivant la localité, et, en raison directe de l'éloignement de la côte et de la profondeur. Mais cependant, sur la côte occidentale de l'île de Brač, c’est-à-dire à une faible distance de la côte et à une profondeur à peine supérieure à celle de la baie de Kaštela, on trouvait au cours de ces recherches du poisson dont la taille n’était pas inférieure à celle de la sardine de Vis, Biševo et Svetac. Sur la côte occidentale de Brač, il arrivait de capturer aussi du petit poisson comme celui que l’on rencontrait d'ordinaire en baie de Kaštela.
15. - Une différence en ce qui concerne l’amplitude des variations du mode dominant et de la taille moyenne a pu être observée entre les régions étudiées. Cette amplitude allait en s'affaiblissant rapidement de la côte vers le large.
16. - Les modifications intervenues dans la composition des lots d’après la taille, dans les régions examinées, n’avaient pas de traits communs, contrairement à ce qu'avait constaté S. M u ž i n i ć (1936) en 1931. Bien plus, elles n’ont pas été identiques dans une même localité au cours d’années consécutives. Cependant, et ceci n'est pas sans importance, certaines de ces modifications ont manifesté une certaine régularité. C’est ainsi que, dans la baie de Kaštela, au cours des années de 1946 à 1948, on a pu enregistrer une réduction sensible de la taille de la sardine entre mai et juillet. Les années 1950 et 1951 ont fait exception à cette règle.
L'apparition de gros poissons dans le canal de Split, tout à fait à la fin de la campagne de pêche régulière et même après, c’est-à-dire pendant la période coïncidant avec la phase de prématuration a, en tout cas, une signification.
17. - L'analyse de la composition des prises, suivant l’âge, a permis d’établir, en baie de Kaštela, la prédominance de groupes d’âge plus jeunes que dans les parages de Vis, Biševo et Svetac, ce qui s'accorde, jusqu’à un certain point, avec la constatation de S. M u ž i n i ć (1936). En se basant sur les résultats de cette analyse, on a pu conclure que la régression de la taille du poisson, dans la baie de Kaštela, entre mai et juillet de 1946 à 1948, a été en relation avec le rajeunissement du stock local dû à l'adjonction du groupe O, à sa prépondérance, et à la disparition presque totale des groupes plus âgés.
18. - L’étude des modifications survenues dans la composition des captures, y compris celles qui se rapportent au nombre de vertèbras, a confirmé la conclusion, établie par le marquage, d’après laquelle la sardine se livre à un déplacement du large vers le littoral au cours de la saison de pêche. Il s’agit ici du déplacement qui affecte les adultes en cours d’année. Cette étude nous a aussi fourni certaines données concernant le voyage rétrograde auquel se livre la sardine adulte en cours d’année, c’est-à-dire côte vers la haute mer. Il semble que ce dernier déplacement doive s'effectuer principalement en dehors de la saison de pêche.
D’apres certaines données, il est permis de conclure que la sardine, au cours de son existence, se déplace du littoral vers le large. S. M u ž i n i ć (1936) avait aussi supposé l’existence d’un tel déplacement.
En tout cas, les données recueillies jusqu’à présent nous incitent à supposer que la sardine évolue à l'intérieur d'un géographique relativement limité.