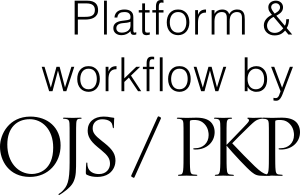Sur quelques facteurs importants de la répartition horizontale du zooplancton adriatique
Abstract
L’apparition et la répartition des formes planctoniques de haute mer dans l’Adriatique orientale, moyenne et septentrionale, présentent un caractère très saisonnier, et ne peuvent être expliquées que par la connaissance du dynamisme général de l’Adriatique, en premier lieu du régime de courants et de la température, de la topographic - c’est-à-dire l’existence d’une assez grande dépression dans le Sud (jusqu’à 1 330 m) dont les eaux communiquent largement, dans l’Otrante (70 km, profondeur jusqu’à 740 m), avec la mer lonienne, c' est-à-dire avec la Méditerranée orientale (profondeur de plus de 5.000 m), ensuite, l’existence de l’archipel de la Dalmatie moyenne, cause de la première plus grande déviation des courants ascendants vers l’Ouest, et celle d'un shelf assez fermé et très peu profond au Nord - ainsi que d’un facteur biotique très important, les migrations verticales, c.-a.-d. le déplacement nocturne des organismes zooplanctoniques des eaux plus profondes et relativement calmes vers les eaux de surface plus agitées.
Etant donné que l’eau méditerranéenne normalement salée atteint justement dans l’Adriatique nord son point le plus septentrional, nombreuses sont es formes du plancton océanique, amenées par les courants venant du Sud, qui y arrivent périodiquement à la péripherie extrême septentrionale de leur distribution géographique. Ce domaine est exposé aux plus larges amplitudes, du régime hydrométéorologique (température, précipitation, vents) ce qui provoque des changement considérable dans la composition de la faune planctonique.
Parnu les formes nombreuses des régions tropicale et subtropicale, répandues dans les oceans et les mers entre les 40° S et 40° N environ (Adriatique: entre les 40° N et 46° N!) dont la présence même dans l’Adriatique est dêjà un fait très intéressant, il faut mentionnner ici trois espèces de Crustacés pélagiques, Siriella thompsoni (M i l n e - E d w a r d s) (Mysidacea), Calamorhynchus pellucidus S t r e e t s et Rhabdosona brevicaudatum S t e b b i n g (Amphipoda), comme des indicateurs excellents des courants ascendants, surtout dans l' Adriatique moyenne et septentrionale (fig. 5). Le nombre de leurs exemplaires actuellement connus dans la Méditerranée occidentale, l’Adriatique - qui sont relativement bien explorées, et dans la Méditerranée orientale qui ne l’est pas assez, (6 (9?) : 156 : 2306), prouve aussi l’influence considérable de cette dernière, qui s’étend le plus loin vers Sud (presque au 30° N), sur l’Adriatique, se trouvent à peu près dans les mêmes latitudes géographiques que la moitié septentrionale de la Méditerranée occidentale. Quelques autres espèces, deparasites, par exemple Ellobiopsis elongata S t e u e r (Ellobiopsidae), Aspidophryxus frontalis B o n n i e r et Prodajus lobiancoi B o n n i e r (Isopoda) indiquent même une certaine différence entre la composition faunistique de l'Adriatique (présentes) et celle de la Méditerranée occidentale (absentes), tandis que, du ce point de vue, le bassin oriental n’est pas encore connu.
La présence de certaines formes des eaux plus profondes et de profondeur dans le domaine de l’isobathe de 100 m à peine (exemplaires adultes et juvéniles de Sagitta hexaptera D’ O r b i g n y, formes juvéniles de Sagitta lyra K r o h n et S. decipiens F o w l e r (Chaetognatha), larves de Chiroteuthis veranyi F é r u s s a c (Cephalopoda), de nombreux Copépodes etc.), dans une grande partie très eloigné des profondeurs de la dépression de l’Adriatique méridionale, auxquelles leur développement ontogénétique est liè, indique la possibilité d'une combinaison de l' »upwelling« et des courants ascendants à l'époque de l’homothermie.
La »retraite« estivale du plancton océanique de l’Adriatique septentrionale, suivi par la »prise du terrain« du plancton néritique (S t e - u e r, 1913) peut être expliquée par le dépérissement progressif des formes océaniques causé par les températures élevées et l’insolation, auxquelles ces élements plutôt sténothermes ne peuvent pas échapper dans ce domaine de faible profondeur. Ce phénomène se manifeste aussi au cours des hivers très froids, ce qui a été déjà indiqué par F r ü c h t l comme probable pour certains Copépodes. Il est donc logique que cela doit se manifester aussi dans les domaines peu profonds et assez fermés des côtes dalmates, où les eaux du Sud pénètrent aussi.
L’écoulement de l’eau de l'Adriatique septentrionale (les courants descendants) poussée par la pénétration des eaux relativement pauvres en plancton, venant du Sud, appauvrirait la fertilité dans ce domaine, s’il n’y avait pas, sur la côte occidentale, de nombreux affluents apportant de l’eau douce, dont le plus important est le Pô. Les domaines autour des embouchures des fleuves fonctionnent comme une barrière même pour de nombreuses formes néritiques, et rares parmi elles sont celles qui y trouvent des conditions de vie optimales. Le fait, que le maximum printanier du macroplancton dans l’Adriatique orientale coïncide avec l’affluence la plus intense de l’eau douce de la côte occidentale, est assez significatif, car c’est ainsi qu’une partie de ce plancton ne peut pas revenir, par les courants descendants, vers l'Adriatique moyenne et plus loin encore. En dehors de ces domaines, la salinité, en tant que facteur de la répartition horizontale, ne peut jouer de rôle important en Adriatique, puisque ces mêmes formes océaniques peuplent l’Océan Indien dont la salinité est 35,5‰.
Les déplacements les plus considérables des frontières de la repartition horizontale du plancton dans l'Adriatique orientale ayant lieu dans sa partie septentrionale peu profonde, jusqu’à une isobathe de 30 m (profondeur approximative à laquelle se forme en été la thermocline - limite supérieure de la répartition verticale de nombreuses formes océaniques des eaux tempérées), comme par exemple au large et dans les eaux de l'lstrie occidentale, il faut mentionner que la composante nocturne du plancton du domaine insulaire voisine (courants qui sortent!) influence vraisemblablement aussi la composition du plancton dans les eaux de l’Istrie méridionale. Les résultats préliminaires et d’autres constatations obtenues dans le domaine del îles de la Dalmatie moyenne montrent que la contribution de cette composante au plancton (diurne) est, non rarement, très considérable, et, parfois même plus considérable que celui-ci même (certaines espèces de Mysidacea, phase pélagique de Polychaeta, etc.). A cause de leur mobilité (type plancto-nectonique) ces éléments échappent généralement aux filets plus petits. Dans le domaine de sortie des courants (île de Drvenik - Rogoznica) leur part dans le plancton est encore toujours considérable. On peu donc, par analogie, supposer la même chose pour les eaux istriennes.
Dans la littérature régionale récente on mentionne »la migration horizontale des organismes planctoniques des eaux profondes de l’Adriatique sud, vers le nord« - expression inadéquate pour englober le problème complexe de la répartition horizontale du zooplancton en Adriatique, exposé ici très sommairement, que l’on ne peut expliquer sans connaître le dynamisme général de cette mer.